A lire : un extrait de "Les Amazones de la terreur" de Fanny Bugnon - CONTRETEMPS (original) (raw)
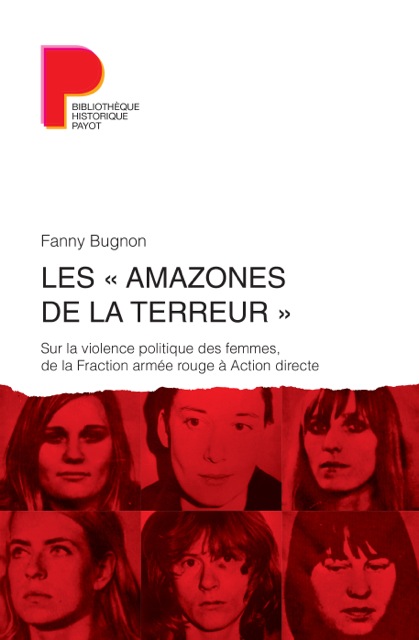
Le texte ci-dessous est l’introduction de Fanny Bugnon, Les « Amazones de la terreur ». Sur la violence politique des femmes, de la Fraction Armée rouge à Action directe, Paris, Payot, 2015, 240 p., 21€.
(Cette introduction compote à l’origine seize notes de fin, les appels de note ayant été supprimés.)
INTRODUCTION
Paris, cimetière du Père-Lachaise, le 18 mars 2006. Au milieu des drapeaux rouges, des femmes et des hommes de générations différentes se rassemblent, en ce jour anniversaire du début de la Commune de Paris, devant le mur des Fédérés. Ce n’est pourtant pas au soulèvement populaire de 1871 que l’on rend hommage, mais à Joëlle Aubron, décédée quelques jours plus tôt, à l’âge de quarante-six ans. Le nom de cette femme est associé à une autre expérience révolutionnaire, en armes elle aussi, mais de nature différente : celle d’Action directe, dont les activités s’étalent sur une période de huit ans, de 1979 à 1987. S’il ne s’agit là ni du premier ni de l’unique groupe à faire de la violence un outil politique dans la France de Valéry Giscard d’Estaing puis dans celle de François Mitterrand, il apparaît comme l’un des plus marquants de l’après-68. Aujourd’hui encore, les noms et les visages de plusieurs de celles et ceux qui firent le choix des armes au nom de la Révolution demeurent associés au nom d’Action directe.
Vingt ans avant cet hommage au mur des Fédérés, le visage de Joëlle Aubron ornait, aux côtés de celui de Nathalie Ménigon, les avis de recherche du ministère de l’Intérieur après l’assassinat de Georges Besse. En 2006, la mort de l’une de celles que la presse surnomma les « amazones de la terreur » ravive le souvenir des images du corps ensanglanté du P-DG de Renault, gisant sur un trottoir parisien un soir de novembre 1986. Revendiqué par Action directe, cet assassinat valut à Joëlle Aubron d’être condamnée en 1989 à la réclusion criminelle à perpétuité avec Nathalie Ménigon, Jean-Marc Rouillan et Georges Cipriani. Vingt ans plus tard, l’évocation de cet attentat considéré comme le plus spectaculaire d’Action directe n’a pas perdu de sa puissance dramatique. Ce souvenir est aussi celui du dernier assassinat revendiqué par l’organisation.
La mort de Joëlle Aubron sonne également le rappel des expériences révolutionnaires armées que la plupart des démocraties occidentales ont connues à compter de la fin des années 1960. En effet, en Allemagne, au Japon, en Italie, en Belgique, en Suisse, au Royaume-Uni ou encore en Espagne, en Grèce, au Canada ou aux États-Unis, mais aussi lors des guerres de décolonisation en Afrique et en Asie, tout comme face aux régimes autoritaires sud-américains, des femmes et des hommes ont, aux quatre coins du globe, fait le choix des armes pour porter les couleurs – « la » couleur pourrait-on dire, même si elle connaît des nuances : le rouge – de la révolution. L’implication de femmes constitue justement l’une des caractéristiques majeures de cette violence révolutionnaire qui s’inscrit dans la conflictualité sociopolitique des années 1968 et dont les déclinaisons s’étirent jusqu’au milieu de la décennie 1990, au-delà de la chronologie généralement envisagée pour penser la révolution par les armes.
Il s’est en effet passé quelque chose dans l’après-68, césure historique, matricielle, à la fois prélude et précipité. Le bouillonnement politique et le renouvellement du militantisme bousculent notamment une partie de la jeunesse qui s’affirme alors comme sujet politique. Loin des blousons noirs antérieurs, de ces « rebelles sans cause » incarnés à l’écran par James Dean, une fraction de la population construit des renouvellements militants, sous de multiples formes, parfois dans le sens d’une radicalisation, d’une intransigeance politique, tant en termes de pratiques que d’analyses. « Révolutionnaire » devient un qualificatif récurrent, omniprésent et la contestation se fait « multiforme, éclatée, polycentrique». Pacifisme, tiers-mondisme, antiimpérialisme, critique du capitalisme, féminisme : le suffixe « -isme » occupe le devant de la scène de la dynamique protestataire d’une période où changer le monde semble à portée de main, où l’utopie se fait réalité, où la critique de l’oppression redessine la nature et les formes du militantisme. C’est donc dans ce contexte que le renouveau contestataire apparu dans le milieu des années 1960 pose la question du militantisme violent en temps de paix.
D’une façon inédite, des hommes et des femmes s’emparent donc, à l’échelle de la planète, de la violence comme d’un outil politique. Ces militantes concentrent tout particulièrement les regards parce qu’elles sont femmes, forgeant une nouvelle catégorie : celle de « femmes terroristes ». L’« homme terroriste », lui, n’existe pas. Il y a, en somme, les « terroristes » et les « femmes terroristes ». L’impensé masculin est coriace, et l’on ne cesse finalement de s’étonner de ce qui apparaît pourtant comme une marque de fabrique de la violence révolutionnaire de l’après-68 : la « féminisation du terrorisme ».
Prises dans un double mécanisme de mise en silence de leur parole et de saturation du discours à leur encontre, ces « femmes terroristes » se trouvent alors confrontées à des tensions, des interférences qui troublent la possibilité de penser la violence politique des femmes. Trois hypothèses principales peuvent être avancées pour comprendre cette difficulté non seulement à voir, mais aussi à penser ce phénomène, aussi bien à l’époque où ces groupes révolutionnaires armés ont été actifs que dans les travaux de sciences sociales sur ces mêmes groupes : une réalité sociale archi-dominée par les violences masculines contre les femmes qui tend à considérer ces dernières dans l’unique position de victimes ; les définitions pénales de la violence qui ne prennent pas toujours en compte la multiplicité de ses formes ; et le faible recensement des faits de violence féminine qui peuvent parfois faire l’objet d’une requalification et d’une certaine mansuétude pénale. À rebours de l’économie générale de la violence, l’implication importante et visible de femmes dans les organisations révolutionnaires armées, loin de passer inaperçue, interpelle, étonne, ou effraie.
Alors, quels outils pour penser ce qui, à la différence de la violence des hommes, apparaît comme une énigme sociale ? En premier lieu, le genre, parce qu’il permet de penser, ensemble et de manière sexuée, la normativité et les mécanismes de régulation sociale, l’évolution des normes et leurs permanences à travers le temps, et donc les dissonances. Surdéterminés par une kyrielle de représentations adossées à des discours de (re)mise en ordre des sexes, les regards sur la violence politique des femmes sont marqués en effet par une hypertrophie tenace qui tend à noyer ces actrices de l’histoire dans un double océan de discours et de silence. Cette tension entre surexposition et omission, entre ombre et lumière, s’explique par le système de valeurs dans lequel la violence politique et la violence des femmes sont prises. Les actrices de la violence révolutionnaire se heurtent ainsi à des catégories qui les dépassent et qui agissent comme autant de stigmates.
La catégorie « terroriste » est indubitablement la plus puissante de ce système de valeurs. Elle supplante progressivement ce que les journaux considèrent jusqu’en 1972-1973 comme de l’« agitation ». Certes, les deux termes ne désignent pas exactement les mêmes choses. L’existence de victimes se trouve ainsi à l’origine du glissement progressif d’une catégorie à l’autre. L’intensification des attentats au cours de la décennie 1970 est avérée : de 35 809 en 1972, les infractions à la paix publique et contre l’État passent à 50 370 en 1976 et à 58 036 en 1978, et, parmi elles, les seules infractions contre l’État sont multipliées par quatre : de 1 532 en 1972 à 6 834 six ans plus tard. La montée en puissance de la radicalisation fait ainsi dire au Monde, le 3 mai 1979, que « tout se passe comme si, désormais, n’importe quel groupe d’agités, n’importe quel individu un peu nerveux, pouvait résoudre leurs fantasmes et exprimer leurs haines à coups d’explosifs ».
Désignées par le qualificatif « terroristes », les partisans de la violence comme moyen mis au service de la révolution se confrontent donc au pouvoir de définition des médias. L’acception n’est pas neutre, loin s’en faut. Une précision s’impose à ce stade : bien que généralement employé de manière extensive pour désigner la violence politique dans ses significations les plus larges, « le terrorisme n’existe pas ; ou plus exactement, ce n’est pas un concept utilisable par les sciences sociales». En raison de son caractère polémique, adossé à des positions morales, le terrorisme tient en définitive de la « notion spongieuse» que les dizaines de définitions de juristes, d’historiens ou de politistes n’ont jamais permis de saisir de manière pleinement satisfaisante. Le terrorisme résonne donc en premier lieu comme une catégorie morale et une injure politique avant d’être une catégorie juridique. Stigmate né des hommes du Comité de salut public qu’on accusa de vouloir faire régner la terreur au nom de la vertu en occultant le « processus juridico-politique de responsabilité collective» qui marque cet épisode de la Révolution française, le « terrorisme » tend à désigner toute forme de violence organisée et illégale, généralement exercée en direction d’un État et de ses symboles, en dehors des normes conventionnelles de la guerre, au nom d’une idéologie. Présenté comme l’arme du faible, il est notamment remis au goût du jour à la Belle Époque pour désigner les attentats des anarchistes, partisans de la propagande par le fait et de l’action directe, et sanctionné par un dispositif juridique spécifique en 1893-1894 contre les « menées anarchistes ». Dans cette perspective, le « terrorisme » peut alors être saisi à partir de ses usages sociaux, à la fois comme une catégorie médiatique et un « personnage historique».
Un personnage historique qui fait néanmoins l’objet de silences historiographiques pour la période de l’après-68, en particulier dans le cas de l’Hexagone. De ce point de vue, la France se distingue des autres pays occidentaux confrontés à la réactivation de la violence révolutionnaire par le relatif silence qu’elle fait sur ce pan de l’histoire contemporaine. La Nouvelle Résistance populaire (NRP), les Groupes d’action révolutionnaire internationalistes (GARI), les Brigades internationales, les Noyaux armés pour l’autonomie populaire (NAPAP), Action directe, l’autonomie, les mouvements indépendantistes basques, bretons, corses, guadeloupéens ou kanaksdemeurent globalement absents des livres d’histoire. Pour reprendre les mots d’Isabelle Sommier, « ces groupes semblent étranges, si ce n’est pathologiques, et leur choix de la violence une hérésie incompréhensible voire irrationnelle. Plus fondamentalement, l’histoire n’aime pas les vaincus, a fortiori lorsqu’ils ont emprunté une voie déviante». Dans son ensemble, la presse française se fait ainsi le relais de ces lectures morales de la violence révolutionnaire et de ses déclinaisons féminines, alimentant aujourd’hui encore la confusion entre histoire et mémoire « légitime » construite par quelques-uns.
Il faut également souligner l’importance des correspondances internationales et tout particulièrement le rôle de miroir – déformant – joué par l’Allemagne dans la perception du phénomène en France. L’histoire commune aux deux pays est loin d’y être étrangère et la violence révolutionnaire est l’occasion de réactiver les stéréotypes nationaux d’un voisin érigé en ennemi quasi héréditaire. De plus, les femmes embrassant la cause révolutionnaire en armes sont visibles outre-Rhin – avec les militantes de la Fraction armée rouge, apparue en 1970 – avant de l’être en France. Ces deux éléments font donc de l’Allemagne le point de référence à partir duquel s’élaborent les représentations hexagonales de la violence politique des femmes, constat que les comparaisons plus rares avec l’Italie et ses Brigades rouges ne remettent pas en cause. Indissociable de la situation française, cette mise en perspective internationale pour penser la « féminisation du terrorisme » illustre la difficulté à considérer le phénomène comme proprement endogène à l’espace et au corps social national. Puisque le recours à la violence au nom de la révolution n’est absolument pas un phénomène propre à la France, comment dès lors analyser ces interprétations qui envisagent la violence politique féminine comme un phénomène en circulation par-delà les frontières ?
Un autre élément doit être intégré à ce rapide tour d’horizon : le renouveau féministe dit de la « seconde vague» qui bouscule la place des femmes dans la société et les rapports entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement les normes de genre et de sexualité. La non-mixité des groupes de femmes, la politisation de l’intime et des questions sexuelles autour de la revendication d’accès à la contraception et de dépénalisation de l’avortement couplée aux pratiques illégales assumées concourent à l’affirmation des femmes comme sujets politiques autonomes. La fabrique socio-historique de cette catégorie qui n’existe qu’au féminin – les « femmes terroristes » – se construit donc également au prisme du potentiel critique du féminisme. Dans le cas de la France, la particularité d’Action directe est d’être considérée comme la première organisation dont les militantes sont visibles. Non pas qu’il n’y ait pas eu de femmes dans les groupes commettant des attentats dans la France de la décennie 1970, mais elles n’ont pas connu une médiatisation comparable.
Bousculant les chronologies classiques, la fabrique des « femmes terroristes » repose non seulement sur le temps de l’événement – attentat, arrestation, procès, libération –, mais mobilise également des boucles référentielles de la violence et du désordre au féminin, où les références mythologiques se mêlent aux figures historiques – en premier lieu desquelles les Amazones – pour penser la violence politique des femmes. En prenant appui sur la médiatisation des « femmes terroristes », depuis l’émergence du phénomène au début de la décennie 1970 jusqu’à son essoufflement au fil des épisodes judiciaires vingt ans plus tard, trois fils guident ici l’analyse : saisir les logiques événementielles et les distorsions chronologiques, mesurer le pouvoir de définition du réel et déterminer le poids des imaginaires sociaux, qui ne sauraient être réduits aux frontières d’un État ou à un unique sigle ou acronyme.
Entre l’indéniable constat de la présence de femmes dans les rangs des groupes révolutionnaires violents (chapitre 1), les hésitations à reconnaître la capacité de celles-ci à faire usage de la violence (chapitre 2), la relativisation de leur autonomie sous couvert de stéréotypes sexués (chapitre 3), ou la dramatisation de leurs responsabilités (chapitre 4), les figures mythologiques et mythiques en circulation (chapitre 5) et l’angoisse liée à la redéfinition des identités de genre (chapitre 6), les actrices de la violence révolutionnaire du second XXe siècle résonnent à la fois comme une catégorie éminemment contemporaine et une nouvelle déclinaison de femmes dissonantes dont regorge l’histoire. Cette double perspective, articulant temps de l’événement et temporalités plus longues, invite ainsi à penser, par-delà les frontières et les époques, la violence politique des femmes.
© Editions Payot & Rivages, 2015.